Nash
Suprème actif

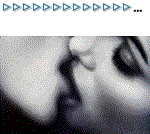
Sexe: 
Age: 42
Inscrit le: 30 Juil 2004
Messages: 7832
Localisation: Somewhere in Belgium...
|
 Posté le: Jeu Juil 14, 2005 17:36 pm Sujet du message: [BELGIQUE] Partie 1
Posté le: Jeu Juil 14, 2005 17:36 pm Sujet du message: [BELGIQUE] Partie 1
Vous l'attendiez, la voici, je viens d'achever la première partie de ma
présentation du pays 
J'aimerais vous faire un peu découvrir mon pays, la Belgique, pas tellement
géographiquement, mais d'un point de vue institutionnel, culturel et
politique pr mieux, par exemple, expliquer pourquoi la majorité des conflits
apparaissant dans mon pays parviennent à trouver une solution de compromis.
Je précise que cette explication est également destinée à la majorité des
Belges qui, comme la majorité des citoyens dans de monde, ne connaît qu'une
petite partie de l'iceberg institutionnel qui peut constituer la structure
d'un Etat.
Avant toute chose, je tiens à dire ceci: mon but ici n'est nullement de faire
croire qu'ici plus qu'ailleurs tout est rose et qu'il n'y a aucun problème.
Que du contraire, nous avons nous aussi notre lot de problèmes, mais la
"démocratie de pacification" (j'en expliquerai le principe par la suite) nous
permet de tenir les différentes parties du pays ensemble.
Je terminerai mon "speech" d'entrée  en espérant ne pas être trop technique ou trop
barbant. Si tel est le cas, veuillez m'en excuser. De même, si certaines
choses ne semblent pas claires, n'hésitez pas à me le signaler en espérant ne pas être trop technique ou trop
barbant. Si tel est le cas, veuillez m'en excuser. De même, si certaines
choses ne semblent pas claires, n'hésitez pas à me le signaler
Bonne lecture !
1 Introduction
-------------------
1 a. La Belgique géographique dans l'Europe
------------------------------------------------------

Commençons par l'une ou l'autre petite chose qui vous permettront de situer
le contexte. La Belgique est probablement, malgré sa petite taille (32.545
km²), le pays le plus "européen" de l'Europe actuelle. De par sa position
géographique tout d'abord: nous côtoyons ainsi les Pays-Bas, la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore le Grand-duché de Luxembourg. De par
ses institutions ensuite: en effet, la Belgique — qui fait partie,
rappelons-le, des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne — est l'Etat
européen comportant le plus d'instances européennes, telles que, par
exemple, le Parlement Européen (partiellement) ou la Commission européenne,
qui ont tous deux leurs sièges respectifs à Bruxelles.
1.b La Belgique géographique interne
----------------------------------------------

Abordons à présent la question de l'aspect interne du pays. Au centre du
pays, Bruxelles, qui est notre capitale. Alors que le Nord du pays (= la
Flandre) possède un relief extrêmement peu prononcé, le Sud (= la
Wallonie), par contre, est doté d'un relief très vallonné et de nombreuses
forêts, relief qui atteint son paroxysme dans les Ardennes (sud-est du pays).
La ligne de séparation entre la Flandre et la Wallonie et en fait une ligne
à peu près horizontale se situant légèrement au sud de Bruxelles. Nous
verrons par la suite que cette ligne est loin d'être une construction
théorique et qu'elle est d'une importance cruciale dans la vie belge. Retenez
simplement pour l'instant que cette ligne est appelée "frontière
linguistique", dont voici le tracé :

En ce qui concerne les villes on remarque que la Flandre comporte un plus
grand nombre de grandes villes que la Wallonie. Parmi les grandes villes de la
Belgique, remarquons par exemple Bruxelles (la capitale), Namur, Liège ou
Charleroi (en Wallonie) ainsi qu'Anvers, Bruges ou encore Genk (en Flandre).
1.c. Aperçu historique
---------------------------
Tout pays, s'il veut être compris (car un pays c'est avant tout une culture,
un état d'esprit), requiert que l'on connaisse au minimum certains traits
essentiels de son histoire, chacun de ces traits ayant contribué à forger le
pays en question.
Je ne vais pas ici vous parler de l'homme de Neandertal ou des Croisades, ce
serait incongru et, dès lors, parfaitement inintéressant 
Entamons si vous le voulez bien notre périple à travers l'Histoire à
l'époque où la Belgique actuelle faisait partie intégrante des Pays-Bas
(attention, les "Pays-Bas" de l'époque c'était, en gros: les Pays-Bas
actuels + la Belgique + le Grand-duché de Luxembourg). Lesdits Pays-Bas
étaient, à l’époque, sous domination autrichienne. En 1789, la
Révolution française éclate. Rapidement, les idées révolutionnaires se
répandent dans les Pays-Bas autrichiens ainsi que dans la Principauté de
Liège. Ces idées génèrent, dans nos régions, une « union des oppositions
» réunissant à la fois des anticléricaux (libéraux) et des cléricaux
(l’Eglise). Les premiers étaient opposés à Joseph II d’Autriche à
cause de l’absence de nombreuses libertés dans le pays, les seconds lui
étaient opposés à cause de sa volonté d’imposer le protestantisme. Pour
rappel, les anti-cléricaux ne sont PAS opposés aux religions, mais bien à
ce qu’elles aient une place dans la politique d’un gouvernement !!!! On a
ainsi de nombreux croyants anti-cléricaux !!!
En 1790, une première révolution se produit, mais elle aboutit à un échec.
Cette révolution avait par ailleurs le soutien de la Grande-Bretagne, qui
voyait en la – future – Belgique un possible futur soutien face à la
puissance française.
En 1792-1793, une deuxième révolution éclate, mais ele aboutit, elle aussi,
à un échec. Cette fois, c’est la France qui soutient, de façon très
claire et ouverte, ce mouvement. Le général français Dumouriez, par
ailleurs ministre, remporte à Jemappes une grande victoire contre les forces
autrichiennes. La Belgique passe alors sous domination française. La loi du
1/10/1795 confirme l’annexion des Pays-Bas autrichiens – principauté de
Liège incluse – à la France. La fin de l’Ancien Régime se situe à
cette époque.
En 1814, Napoléon est vaincu à Waterloo. Les troupes coalisées contre lui
reprennent la Belgique et rétablissent les Pays-Bas, via le Traité de Paris
(30/5/1814). La Belgique se voit donc rattachée à nouveau aux Pays-Bas. Le
31 juillet de cette même année, Guillaume d’Orange-Nassau devient
gouverneur général de Belgique, en accédant au trône de la maison
d’Orange. Ce faisant, l’espoir d’une 3ème révolution s’envole.
C’est également à ce moment qu’est rédigé ce qu’on appellera «
l’acte des 8 articles » dans lequel le souverain de Pays-Bas reconnaît
que, même si les Pays-Bas forment un seul Etat, ils sont formés de deux pays
(Pays-Bas actuels + Belgique actuelle). Il reconnaît donc une spécificité
belge.
Toujours en 1814 est rédigée la « loi fondamentale », qui n’est autre
que la première Constitution du Royaume des Pays-Bas. Celle-ci comportait des
éléments de nature à favoriser les mécontentements dans notre pays :
ainsi, ce sont d’une part le Roi et d’autre part les Etats généraux qui
exerçaient la fonction législative. Mais surtout, le principe de séparation
des pouvoirs était totalement ignoré, de même que le principe de
responsabilité ministérielle. Enfin, le Roi se voyait attribuer des
prérogatives étendues.
Cette Constitution – applicable dans tous les Pays-Bas – déclenche de
très vives réactions. Trop vives, au goût de Guillaume 1er, qui décide
alors de mettre sur pied une Commission de révision de la Constitution.
Celle-ci était constituée de 11 hollandais et de 11 belges. Cette commission
provoque la colère de l’Eglise qui y voit une commission anti-cléricale
capable de mettre sur pied une révision de la Constitution qui le soit tout
autant. Un projet de révision est adopté et envoyé aux Etats généraux.
Lors du vote aux Etats généraux, on voit l’apparition de l’arithmétique
hollandaise (sur 1323 votes, 527 ont voté pour, 796 contre. Mais on
considéra alors que les 126 votes négatifs motivés par des raisons
religieuses n’avait pas lieu d’être – sous le prétexte que cette
attitude était en contradiction avec les 8 articles – donc on considéra
qu’ils avaient en fait voté « oui » ; de même, on considéra que les
280 notables n’ayant pas voté avaient eux aussi voté oui. La minorité se
transforma donc en majorité...).
Mais cette révision, telle qu’adoptée, déclenche un ouragan de critiques.
1) De la part de l’Eglise tout d’abord, opposée au protestantisme
d’Etat du Prince d’Orange. 2) De la part des francophones de Belgique
ensuite, opposés à la néerlandisation du pays. Notons que les Flamands, eux
aussi, sont opposés à cette néerlandisation. N’oublions pas, en effet,
qu’en Flandre comme en Wallonie, l’immense majorité de la population de
l’époque parle dans des patois locaux.
3) De la part des libéraux enfin qui stigmatisent l’absence de nombreuses
libertés, telle la liberté de presse, remplacée par un « drukpers »
(nécessité d’obtenir une autorisation du pouvoir pour éditer / imprimer
quelque chose)
Ces critiques déclenchent une nouvelle « union des oppositions »
(catholiques + libéraux), dotée d’un programme commun : inviolabilité des
droits publics, responsabilité ministérielle, compétence du jury, liberté
des langues, liberté de l’enseignement.
Suite à ces protestations de plus en plus fortes, Guillaume 1er accepte, en
1829, quelques concessions, mais celles-ci, très minimes, ne peuvent ralentir
le mouvement révolutionnaire qui va suivre.
On estime que c’est le 25 août 1830, lors de la représentation, à
Bruxelles, de la Muette de Portici, que l’étincelle se déclenche. Des
émeutes soulèvent alors toute la ville. Quelques jours plus tard, c’est le
pays tout entier qui est en pleine révolte contre l’autorité
néerlandaise. Les frustrations si longtemps contenues, accumulées au cours
de nombreuses décennies d’occupation – qu’elle soit autrichienne,
française ou hollandaise – trouvent là un exutoire.
Le 23 septembre, réalisant l’ampleur du mouvement, Guillaume 1er envoie son
fils, le Prince Frédéric à Bruxelles avec toute une armée. Mais la
résistance bruxelloise est telle que, dans la nuit du 26 au 27, le Prince
ordonne le retrait de l’armée néerlandaise. Ce retrait sonne la fin du
joug néerlandais en Belgique, et l’indépendance de celle-ci.
Dès le 26 septembre donc, l’autorité royale de Guillaume 1er n’est plus.
Un gouvernement provisoire est alors mis en place à Bruxelles. Le 4 octobre,
via un décret constituant, l’indépendance de la Belgique est
officiellement déclarée mais il faudra attendre le 19 avril 1839 pour que,
via un traité, les Pays-Bas reconnaissent enfin la Belgique et son
indépendance.
En 1831, le pays se dote d’une nouvelle Constitution. Celle-ci, bien
qu’étant un patchwork composé à 90% d’extraits d’autres constitutions
(française, hollandaise, anglaise), comporte également certains éléments
complètement révolutionnaires et inconnus à l’époque, tels l’égalité
de droits et la garantie de la liberté individuelle, la liberté des cultes
et la liberté de l’enseignement, la liberté de la presse, la liberté de
réunion, d’association et de pétition ou encore la liberté linguistique
– cette dernière, fort théorique, sera détaillée par la suite. La
séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) était
également une des pierres angulaires de cette nouvelle Constitution.
La liberté linguistique, bien qu’inscrite dans la nouvelle Constitution,
était fort peu appliquée à l’époque. En effet, la quasi-totalité des
notables, des grands industriels, et des responsables politiques de
l’époque étaient des francophones, issus majoritairement de la Wallonie,
beaucoup plus riche et prospère à cette époque (notons que la tendance
s’est complètement inversée à l’heure actuelle) grâce à l’industrie
lourde. N’oublions pas, en effet, que pendant plusieurs années, la Belgique
a été la première puissance industrielle au monde, détrônant des Etats
tel que les Etats-Unis ou encore la Grande-Bretagne.
Cette domination outrecuidante des francophones dans l’Etat va donner
naissance au Mouvement flamand (« Vlaams Beweging ») qui, de pacifique et
belgicain à l’origine va peu à peu, au fil des décennies, devenir de plus
en plus dur, nationaliste, extrémiste et séparatiste. Une partie de ce
mouvement collaborera d’ailleurs activement, au cours des deux guerres
mondiales, avec lez nazis.
Suite à la reconnaissance de la Belgique par les Pays-Bas en 1839,
l’unionisme (c’est-à-dire le sentiment qu’ont tous les Belges
d’appartenir à une même nation) en prend un coup, puisqu’une des
principales menaces envers l’indépendance de la Belgique s’effaçait
alors.
Aujourd’hui donc, la tendance s’est inversée. La Flandre est une des
régions les plus riches du monde, de par sa capacité très élevée
d’entreprendre mais également car elle n’a pas eu le besoin, comme l’a
eu la Wallonie, d’effectuer de lourdes réformes structurelles et
industrielles pour passer de l’industrie lourde aux entreprises plus
récentes, travaillant beaucoup plus dans les secteurs secondaires (production
de détail) et tertiaires (services). Cependant, cette très bonne santé
économique s’accompagne hélas d’un nationalisme exacerbé. Ce
nationalisme a entraîné l’image forte du « Wallon volant le pain des
Flamands » car la sécurité sociale, qui est encore à l’heure actuelle
une compétence de l’Etat fédéral, est donc financée par tous les Belges
et s’adresse à tous les Belges. Dès lors que les Wallons sont moins riches
que les Flamands, ils bénéficient donc plus de la sécurité sociale.
Ce nationalisme exacerbé, couplé à une mauvaise volonté de la part des
francophones qui ont longtemps refusé d’écouter les – légitimes –
revendications flamandes de l’époque, a entraîné (et entraîne encore à
l’heure actuelle) de nombreux conflits entre le Nord et le Sud du pays.
2 L'organisation politique et institutionnelle
----------------------------------------------------
Pr les audacieux ayant eu le courage (disons même l'abnégation mdr) de me
lire jusqu'ici, il me faut vous prévenir que cette partie est loin d'être la
plus facile à comprendre, c'est pourquoi je vais tenter de présenter les
choses de façon claire et pas trop barbante 
Tout d'abord parlons du type de régime en Belgique, là, rien de très
compliqué: la Belgique est une monarchie constitutionnelle. Cette expression
signifie que c'est une monarchie (donc avec une dynastie, un Roi et une Reine,
des princes etc) mais où le Roi ne dispose d'aucun pouvoir personnel, les
seuls pouvoirs qu’il a (pouvoirs souvent symboliques à l’heure actuelle)
sont ceux que lui attribue la Constitution
Ensuite, et c'est là que les Romains s'empoignèrent  , il faut
bien se rendre compte qu'à l'extrême opposé de certains Etats tels que la
France, où la centralisation est extrême, la Belgique est (depuis 1970 en
pratique, depuis 1980 en théorie) un Etat fédéral, où les pouvoirs sont
multiples et extrêmement ventilés. Ce qui signifie qu'en Belgique il n'y a
pas qu'un seul pouvoir politique (le pouvoir de l'Etat belge) mais qu'au
contraire il y a de multiples autres subdivisions dans le pays, celles-ci se
superposant les unes aux autres. La raison en est claire pour tout qui
connaît un tant soit peu le pays: nous avons en Belgique deux grandes
communautés (les Wallons - francophones - et les Flamands - néerlandophones)
qui, avant 1970 et la transformation de l'Etat unitaire en Etat fédéral,
entraient très souvent en conflit, pour de multiples raisons. Les principales
sources de frustration étaient celles-ci: comme je l'ai déjà évoqué au
1.c, le mouvement flamand a, dès ses débuts, demandé que la Flandre soit
compétente pour décider elle-même de toute une série de choses dans des
domaines très divers, qu'il s'agisse par exemple du domaine culturel ou du
domaine institutionnel et politique. , il faut
bien se rendre compte qu'à l'extrême opposé de certains Etats tels que la
France, où la centralisation est extrême, la Belgique est (depuis 1970 en
pratique, depuis 1980 en théorie) un Etat fédéral, où les pouvoirs sont
multiples et extrêmement ventilés. Ce qui signifie qu'en Belgique il n'y a
pas qu'un seul pouvoir politique (le pouvoir de l'Etat belge) mais qu'au
contraire il y a de multiples autres subdivisions dans le pays, celles-ci se
superposant les unes aux autres. La raison en est claire pour tout qui
connaît un tant soit peu le pays: nous avons en Belgique deux grandes
communautés (les Wallons - francophones - et les Flamands - néerlandophones)
qui, avant 1970 et la transformation de l'Etat unitaire en Etat fédéral,
entraient très souvent en conflit, pour de multiples raisons. Les principales
sources de frustration étaient celles-ci: comme je l'ai déjà évoqué au
1.c, le mouvement flamand a, dès ses débuts, demandé que la Flandre soit
compétente pour décider elle-même de toute une série de choses dans des
domaines très divers, qu'il s'agisse par exemple du domaine culturel ou du
domaine institutionnel et politique.
Jusque 1970 donc, la Belgique était un état unitaire. Seules deux sortes
d’entités "locales" existaient déjà à l'époque, mais celles-ci sont (et
c'est important) subordonnées au pouvoir fédéral. En d'autres termes,
jusque 1970, le seul pouvoir politique qui existait en Belgique était celui
joué par l'Etat. Ces deux sortes d’entités locales étaient d'une part
les communes (qui existent tjs à l'heure actuelle, bien qu'en nombre
restreint - 589 - depuis la fusion des communes en 19XX) qui sont en fait des
"villes" si vous voulez, et d'autre part les provinces. En ce qui concerne ces
dernières, jusque 1995, la Belgique comptait 9 provinces. Depuis la réforme
de l'Etat de 1995 donc, suite à l'apparition très nette de la frontière
linguistique dans les textes de lois, une des provinces (le Brabant) s'est
"divisée" en trois parties: Bruxelles-Capitale, le Brabant wallon et le
Brabant flamand, les deux derniers constituant désormais chacun une province
à part entière.

Le sort de Bxl est un peu particulier car, puisqu'il est le siège de
nombreuses luttes politiques entre le mouvement flamand et le mouvement
wallon, il a été décidé de l' "extraprovincialiser", c’est-à-dire de ne
le considérer comme ne faisant partie d'aucune province donnée (d'où mon "
trois parties" de ci-dessus)
La raison d'être des communes et des provinces est fort simple: tout d'abord,
l'Etat ne saurait s'occuper des problèmes de toute la Belgique s'il n'y
dispose pas d'intermédiaires à même d'appliquer ses décisions (précisons
ici que les communes et provinces sont quand même, pour un certain nombre de
matières, partiellement autonomes, l'Etat ne leur dicte pas tout !). La
deuxième raison en est que cela permet au citoyen de se sentir plus proche
des institutions politique s'il a affaire à des gens de sa région et
connaissant les problèmes y afférant que s'il a affaire à des gens qui,
n'étant pas du coin, ne peuvent par conséquent pas connaître à fond les
problématiques locales.
Depuis 1970 sont apparues d’autres autorités étatiques, venues s’ajouter
à l’Etat, aux provinces et aux communes. Il s’agit des Communautés et
des Régions.
Les
Communautés
Il s’agit ici de regrouper dans une même institution les gens ayant la
même culture et / ou la même langue. On a donc 3 Communautés :
1) La Communauté française

2) La Communauté flamande

3) La Communauté germanophone

Chaque communauté a son gouvernement et son Parlement. Les compétences des
communautés se situent plutôt dans le domaine des personnes (exemple :
l’enseignement)
Les
Régions
Il s’agit ici de regrouper dans une même institution une partie de
territoire. On a donc 3 Régions :
1) La Région de Bruxelles-Capitale

2) La Région flamande

3) La Région wallonne

Chaque Région a son gouvernement et son Parlement. Les compétences des
Régions sont liées au territoire : exemple : l’environnement, les déchets
etc...
SUITE AU PROCHAIN EPISODE 
|