Souki
Modératrice

Sexe: 
Age: 38
Inscrit le: 05 Nov 2011
Messages: 3273
Localisation: Lyon
|
 Posté le: Mar Jan 28, 2014 08:23 am Sujet du message: La grammaire et le vocabulaire de Genaisse
Posté le: Mar Jan 28, 2014 08:23 am Sujet du message: La grammaire et le vocabulaire de Genaisse
Bon, ok, on est en section philo mais je ne voyais pas où mettre ça
ailleurs.
Je voulais donc compiler ici quelques points de langue. Toute personne ayant
des questions sur l'orthographe peut poster une question ici, je m'engage à
lui répondre ou à faire des recherches si je ne sais pas répondre.
Go.
|
Souki
Modératrice

Sexe: 
Age: 38
Inscrit le: 05 Nov 2011
Messages: 3273
Localisation: Lyon
|
 Posté le: Mar Jan 28, 2014 09:13 am Sujet du message:
Posté le: Mar Jan 28, 2014 09:13 am Sujet du message:
L'accord du participe passé, le
fameux.
La règle, je la rappelle, est celle-ci :
Le participe passé d'un verbe à une de ses formes composées
(auxiliaire+participe) s'accorde ou non dans certaines conditions :
1. Si l'auxiliaire est être, le
participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.
ex : Marie est partie.
2. Si l'auxiliaire est avoir, le
participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet mais avec le COD si
celui-ci est placé devant le participe passé.
ex : Marie a mangé des
gâteaux.
Marie les a mangés.
3. Verbe pronominaux (ex : se laver) se conjuguent avec l'auxiliaire être.
Les pronominaux réfléchis ou réciproques peuvent s'accorder. Nous allons
voir quand. Quoi qu'il arrive, on peut décomposer les pronominaux comme ceci
:
Elle s'est lavée. = Elle a lavé elle-même.
Elle s'est demandé. = Elle a demandé à elle-même.
Un pronom réfléchi, c'est un mot qui reprend et répète le sujet. Quand je
dis je me lave, me renvoie à moi, je, c'est-à-dire
le sujet. C'est réfléchi comme mon image se réfléchit dans un miroir.
Un pronom réciproque, c'est un pronom qu'on peut utiliser avec un sujet au
pluriel et qui signifie l'un l'autre.
Quand je dis ils se saluent, on
comprend bien que chaque personne ne se salue pas elle-même mais que A salue
B, qui salue A. Ils se saluent l'un l'autre,
ils se saluent réciproquement.
Si le verbe pronominal réfléchi ou réciproque se décompose en : aux. avoir
+ participe passé + lui-même/l'un l'autre, on accorde.
Ils se sont salués. -> Ils ont salué
l'un l'autre.
Nous nous sommes levés. -> Nous avons levé nous-mêmes.
Dans les deux cas, on accorde avec le sujet.
Alors pourquoi
? Pourquoi une règle si compliquée ? La réponse, c'est tout
simplement que c'est logique.
Quand un verbe est pris au participe passé, il se met à fonctionner comme un
adjectif. D'ailleurs, il y a des fois où il est bien difficile de savoir si
un mot est un adjectif ou un verbe. Si je vous dis d'une personne qu'elle est
enrobée, est-ce un verbe ou un
adjectif qualificatif ? Le participe, c'est la forme adjectivale du verbe,
comme l'infinitif est la forme nominale du verbe. On peut facilement rajouter
un article devant un verbe à l'infinitif : le parler (-vrai), le vouloir,
certains sont mêmes tellement vieux qu'on a oublié qu'ils étaient des
verbes comme le baiser. Revenons au
participe passé.
J'ai besoin d'un autre outil pour expliquer la règle de l'accord du participe
passé alors je fais une autre parenthèse. Un verbe peut être intransitif,
transitif direct ou transitif indirect.
Un intransitif, c'est un verbe qui fonctionne tout seul avec son sujet.
ex : Je nage. Je marche. Il pleure.
Un verbe transitif, c'est un verbe qui a besoin 'un complément pour
fonctionner. Si le complément peut être collé directement, c'est un
transitif direct, si le complément a besoin d'un petit mot pour faire tampon,
c'est un transitif indirect.
ex : J'aime les surprises. / J'aime sortir. /
J'aime Pierre. -> transitif direct.
ex : Je pense à cette
journée. / Je pense à
Pierre. -> transitif indirect
Or, les transitifs directs ont une propriété assez particulière : ils
peuvent échanger le sujet et le COD. C'est la fameuse forme passive.
Le chat mange la souris. -> La souris est
mangée par le chat.
Si on met cette phrase au passé composé, cela donne :
Le chat a mangé la souris. La souris a été mangée par le chat.
Si on contracte le COD en pronom, ça donne : Le chat l'a mangée. On retombe sur le cas où le participe
passé s'accorde avec le COD.
La raison de cet accord est donc celle-ci : puisque le participe est la forme
adjectivale du verbe, le participe renvoie à un aspect de quelque chose. un
aspect de quoi ? De qui ? Dans le cas du chat et de la souris, qui est mangé
? C'est bien la souris. Mangée, c'est
bien l'état de la souris, certainement pas celui du chat donc on accorde.
À chaque fois qu'il y a accord, ça veut dire que le participe passé décrit
celui avec lequel on accorde.
Je suis partie ce matin. Qui est dans
l'état parti ? C'est bien moi.
Je me suis demandé. Qui est dans
l'état demandé ? Personne. Bon, on
n'accorde pas.
Ils ont décrit la forêt. Qui est dans l'état décrit ? La forêt, mais au moment où je
dis décrit, on ne le sait pas encore,
alors ça ferait bizarre d'accorder. Par contre, quand je dis Ils l'ont décrite, mon interlocuteur sait
déjà que je parle de la forêt alors il faut accorder.
Voilà voilà.
|
Zen
Super actif


Sexe: 
Inscrit le: 08 Avr 2011
Messages: 2524
|
 Posté le: Mar Jan 28, 2014 12:54 pm Sujet du message:
Posté le: Mar Jan 28, 2014 12:54 pm Sujet du message:
J'ai pas encore tout lu mais j'avoue avoir des lacunes donc j'apprécie plus
encore ce topic.
Un conseil pour les parents et futurs parents de ce forum, éviter les
changements d'école parce que passé d'un début de programme sur les
pharaons dans un établissement, aux carolingiens dans un autre, ça n'aide
pas à comprendre l'histoire et c'est pareil pour le programme de français.
Merci Souki.
|
Pixelle
Genaissienne de l'année 2013
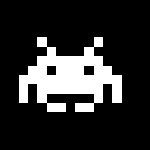
Sexe: 
Inscrit le: 25 Avr 2011
Messages: 4750
|
 Posté le: Mar Jan 28, 2014 21:06 pm Sujet du message:
Posté le: Mar Jan 28, 2014 21:06 pm Sujet du message:
Ca fait du bien de revoir les bases, surtout lorsqu'on ne les a pas bien
acquises étant plus jeune.
Merci Plasma, je vais suivre avec une certain attention ce topic.
|
Tommy Angello
Administrateur


Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2006
Messages: 4354
Localisation: dans ton cpu
|
 Posté le: Mar Jan 28, 2014 22:06 pm Sujet du message:
Posté le: Mar Jan 28, 2014 22:06 pm Sujet du message:
Oulala...
J'aurais plusieurs questions.
Premièrement, c'est quoi un auxiliaire?
|
Souki
Modératrice

Sexe: 
Age: 38
Inscrit le: 05 Nov 2011
Messages: 3273
Localisation: Lyon
|
 Posté le: Mer Jan 29, 2014 12:32 pm Sujet du message:
Posté le: Mer Jan 29, 2014 12:32 pm Sujet du message:
C'est cool que ça motive certains ! J'ai testé la méthode sur une élève
de 4° hier et il se trouve que ça a l'air de mieux fonctionner que
l'apprentissage de la règle.
Donc, à retenir :
As-tu trouvé
la recette ? Oui, je l'ai trouvée. -> qui est trouvé ? La recette.
-> Est-ce qu'on a déjà parlé de la recette au moment où on dit
«trouvé» ? Dans la réponse, oui -> -ée
On arrête de se prendre la tête avec le COD et sa place dans la phrase.
Tommy, en grammaire, on appelle «auxiliaire» un mot qui aide le verbe à se
conjuguer d'une certaine façon. En français, on a deux auxiliaires : être
et avoir. En anglais, puisque le verbe ne se conjugue pas vraiment, il y en a
beaucoup plus : might, ma, can, could, will, etc.
Après, le français a aussi des semi-auxiliaires mais ceux-là ne posent pas
de problème particulier.
ex : dans je vais venir, on est
vraiment dans un fonctionnement similaire à l'anglais, avec le verbe aller
qui perd son sens de déplacement et qui prend à la place une valeur de
d'expression du futur proche. Le semi-auxiliaire donne un temps au verbe sans
le conjuguer.
Quand tu conjugues un verbe à un temps composé (ex : jouer -> j'ai
joué), le verbe avoir a bien sa valeur d'auxiliaire puisque le sens «avoir,
posséder» n'intervient pas du tout.
ex : J'ai un livre équivaut à je possède un livre.
J'ai trouvé un livre n'équivaut pas
à *je possède trouvé un livre.
Dans ce dernier cas, on a bien affaire à l'auxiliaire et non au verbe
«avoir».
Le mot «auxiliaire» vient du latin «auxiliarum» : venant à l'aide. En
grammaire, c'est le mot qui aide le verbe à se conjuguer et dans le monde
médical, l'auxiliaire de vie est celui qui aide à vivre.
|
Tommy Angello
Administrateur


Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2006
Messages: 4354
Localisation: dans ton cpu
|
 Posté le: Mer Jan 29, 2014 20:17 pm Sujet du message:
Posté le: Mer Jan 29, 2014 20:17 pm Sujet du message:
Tu viens de m'apprendre plus de francais que deux ans d'éducation nationale.
Je m’intéresse surtout au sujet par curiosité, mon francais est destiné
à ressembler au grolandais. C'est une cause perdue. Je pars du principe que
la langue est un media et que tant que tout le monde comprend, c'est du
français correct.
J'ai jamais osé demandé en cours: c'est quoi un objet, pourquoi on le
complète et en quoi il est direct indirect?
|
chiron
Actif


Sexe: 
Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 1191
|
 Posté le: Mer Jan 29, 2014 21:07 pm Sujet du message:
Posté le: Mer Jan 29, 2014 21:07 pm Sujet du message:
Bravo Souki pour le topic ! Même si, en bon anarchiste, je ne reconnais
aucune règle ni dieu ni maître  Mais bon pour toi, je fais un effort... Mais bon pour toi, je fais un effort...
Sinon pourrait-on coupler un nombre limitées de règles ...avec une nouvelle
dans laquelle un auteur qui utilise fréquemment des syntaxes en rapport avec
les règles ?
Cela pourrait donner une préface avec l'explication des règles.
Bien entendu ensuite l’œuvre courte avec les syntaxes étudiées en gras.
Puis un QCM d'auto-évaluation sur des phrases de l’œuvre à la fin.
Cela serait plus fun tout de même... Mais je ne sais pas si cela existe.
Car pour les formes musicales, c'est souvent payant. Par exemple pour les
accords de 7ème (Do-mi-sol-si en do majeur) je conseillais souvent après
explications de faire deux ou trois morceaux de Michel Jonasz. Comme il ne
fait souvent que cela et de toutes les manières possibles, après ces trois
morceaux, on maîtrise toute la technique des accords de 7èmes, ce qui est
très pratique en jazz...
|
Souki
Modératrice

Sexe: 
Age: 38
Inscrit le: 05 Nov 2011
Messages: 3273
Localisation: Lyon
|
 Posté le: Ven Jan 31, 2014 00:13 am Sujet du message:
Posté le: Ven Jan 31, 2014 00:13 am Sujet du message:
Chiron : arrête le crack.
| Tommy Angello a
écrit: | | J'ai jamais osé
demandé en cours: c'est quoi un objet, pourquoi on le complète et en quoi il
est direct indirect? |
Question très pertinente, que tu aurais dû poser à un prof calé en
grammaire. C'est dommage, ce n'était pas une question sotte, quoique mal
posée à la fin (mais ça, c'est parce qu'on ne t'a pas expliqué la chose en
profondeur).
Une phrase est un petit système dont le moteur est le verbe. C'est le noyau,
c'est là que ça se passe. La plupart des phrases racontent l'histoire d'un
changement. Ce changement, ce mouvement, c'est le verbe qui le dit. À part
les verbes d'état (être, paraître, sembler, etc, la liste est très
courte), un verbe donne une action. Cette action a un sujet et un objet.
Le sujet, c'est celui qui initie l'action. L'objet, c'est celui qui n'a rien
demandé à personne et qui subit l'action.
Le chat mange la souris : la souris
aurait préféré rester tranquille dans son coin, le chat par contre, il a
faim, alors il désire manger, il va se mettre en mouvement pour cela bref :
il va agir.
Elle parle à sa sœur : idem, c'est
elle qui a quelque chose à dire, qui désire rompre le silence, la sœur, de
son côté, est le réceptacle passif de la parole. Elle n'a pas besoin de
désirer quoi que ce soit, elle est donc l'objet.
Elle parle de son copain à sa sœur :
idem, le copain fait l'objet de la conversation.
À retenir donc : un verbe, c'est une action c'est-à-dire un désir qui
s'accomplit. Un sujet, c'est ce qui réalise cette action. Un objet, c'est ce
qui subit cette action.
Quand on dit «Complément d'Objet», on renvoie aux mots qui complètent
le verbe en précisant son
objet. De la même manière, le «complément circonstanciel» complète le
verbe en nous renseignant sur les circonstances dans lesquelles l'action se
réalise.
Maintenant, COD, COI. Un complément d'objet peut être direct ou
indirect. Ça veut simplement dire que dans certains cas, on peut exprimer
l'objet directement, dans certains autres, il faut un petit mot invariable
pour faire tampon : une préposition.
La préposition, c'est un mot qui n'a de sens que dans certaines
circonstances. Il y en a relativement peu : à, dans, par, pour, en, vers,
avec, de, sans, sous, sur, ... Certains verbes ont besoin de ce petit mot pour
fonctionner. Ça n'a pas forcément d'incidence sur le sens, c'est juste
comme ça que le mot s'est formé. La preuve : «se souvenir» et «se
rappeler» ont le même sens et ne se construisent pas de la même manière
(même si nous assistons actuellement à la disparition de cette
caractéristique).
Je me souviens de cette
année. -> «se souvenir» est un transitif indirect qui a
donc un COI
Je me rappelle cette année. -> se rappeler est un transitif
direct, qui a donc un COD
Quand tu peux exprimer ton objet sans passer par une préposition, COD. Quand
tu as besoin d'une préposition pour exprimer ton objet, COI. Cette
distinction est souvent rendue incompréhensible par la confusion entre les
prépositions (à, dans, par, pour, en, vers, ...) et les articles (le, la,
les, un, une, mon, tes, etc) qui font eux partie de l'objet. Pour éloigner
tout doute, il suffit de remplacer l'objet par un verbe à l'infinitif ou un
nom propre.
Il veut une glace. -> Il veut partir. /
Il veut Marie.
Il tient à la vie. -> Il tient à vivre. / il tient à Marie.
On peut faire disparaître l'article, pas la préposition.
Et voilà voilà...
|
Souki
Modératrice

Sexe: 
Age: 38
Inscrit le: 05 Nov 2011
Messages: 3273
Localisation: Lyon
|
 Posté le: Jeu Fév 06, 2014 09:23 am Sujet du message:
Posté le: Jeu Fév 06, 2014 09:23 am Sujet du message:
Allez, on reprend avec l'impératif présent
et sa conjugaison à la deuxième personne du singulier
(P2).
D'abord, je voudrais revenir sur la notion de mode. L'impératif n'est pas un
temps mais un mode, au même titre que l'indicatif, le subjonctif, le
conditionnel mais aussi l'infinitif, le participe et le gérondif. On se
souvient qu'un verbe est une action. Le mode, c'est la façon de placer
l'action et le temps, c'est le moment auquel on la place.
Avec l'indicatif, on place l'action dans la réalité ou plutôt dans
l'actualité. Cette réalité peut être présente (J'écris un message sur Genaisse), passée (J'ai déjà écrit un certain nombre de messages
sur Genaisse) ou future (J'écrirai
d'autres messages). Au subjonctif, on est dans le virtuel ou, pour
être pointilleuse, dans la modalisation : quand je dis Il faut que tu ailles chercher du pain,
l'action aller n'est pas réalisée
mais elle est souhaitée. À l'impératif, on exprime un ordre ou un conseil.
Va chercher du pain exprime en
apparence la même chose que Il faut que tu
ailles chercher du pain mais il y a en fait une nuance subtile : avec
l'impératif, j'accomplis un acte à part entière, puisqu'en parlant,
j'ordonne, je m'engage pleinement. Avec l'autre formulation, j'exprime mon
souhait en me mettant à ma place de demandeur, bref, j'y crois un peu moins
ou bien je prends quelques précautions.
La conjugaison ne pose pas de problème particulier aux deuxième et
troisième groupes puisqu'elle est vraiment calquée sur le présent de
l'indicatif.
Finir : finis !, comme au présent
tu finis
Prendre : prends ! comme au présent
tu prends.
Par contre, au premier groupe, les choses se corsent puisque le -s, le fameux
-s de la P2, qui est une constante à tous les temps peut disparaître et
réapparaître. On écrit en effet : Joue de la guitare pour moi !
sans -s, ce qui ne nous empêchera pas d'écrire Tu joues de la guitare ? Joues-en pour moi !
Alors que se passe-t-il ? En fait, c'est assez simple : à l'impératif, pas
de -es en P2 pour les verbes du premier groupe (les verbes en -er) mais
simplement un -e, sauf quand on en a besoin pour faire la liaison. Ça marche
aussi pour le verbe aller, qui
appartient au premier groupe.
Va chercher du pain, vas-y.
Regarde cette émission !
Mange ton assiette, et
légumes aussi, manges-en.
Donc tant qu'il n'y a pas de liaison à faire, on ne met pas de -s. On note au
passage que le -s apparaît systématiquement avant en et y, comme dans les
exemples ci-dessus.
|